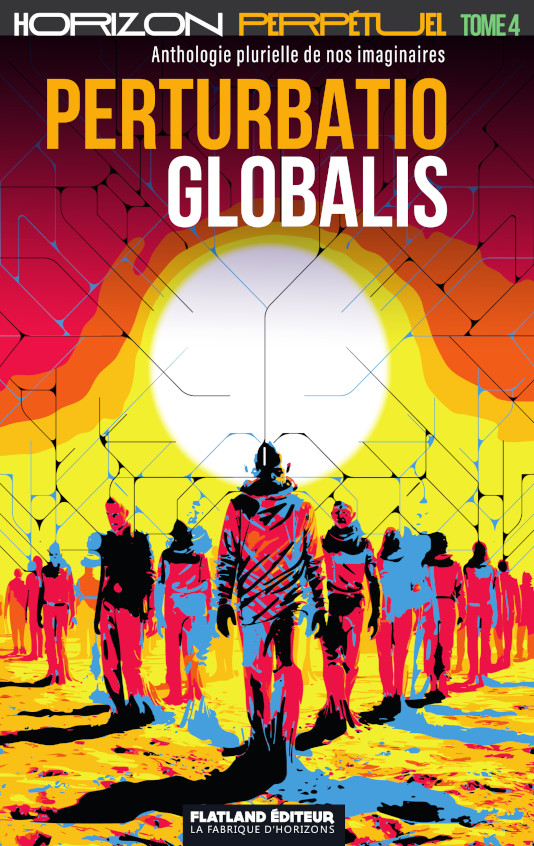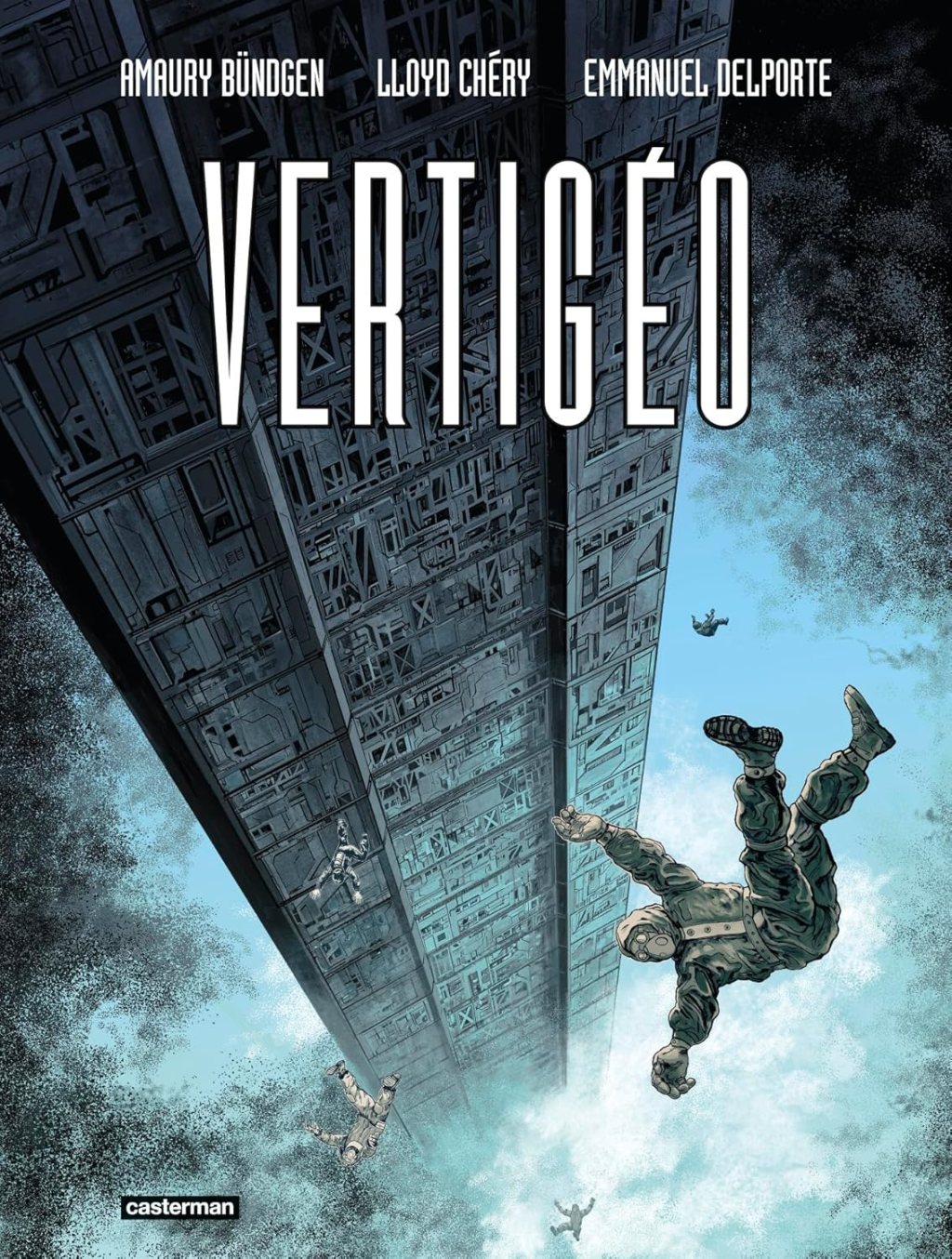C’est avec un mélange de stupéfaction et de profonde tristesse que je viens d’apprendre le décès de mon ami Patrice Quélard, survenu le 21 février 2026. Si j’ai bien compris, il a été victime d’un malaise cardiaque en randonnée au Chili et a fait une chute fatale.
J’avais rencontré Patrice grâce à nos aventures éditoriales respectives. C’était un homme d’une générosité rare, une personne qui tenait sa parole et dont la franchise et l’honnêteté s’accordaient avec une force physique et mentale qui faisaient mon admiration. Patrice ne trichait pas, ni avec l’écriture, ni avec ses engagements communautaires, que ce soit comme directeur d’école ou dans ses actions visant à aider les migrants Syriens. Un homme de cœur, victime d’une cruelle ironie du sort, et parti trop tôt. Il n’avait que 53 ans.
Après s’être fait la main en écrivant des nouvelles et des romans pour de petites maisons d’édition, Patrice avait fini par percer le plafond de verre avec ses deux romans publiés chez Plon, qui mettaient en scène un héros à son image, droit et sans langue de bois. « Place aux immortels » avait remporté le grand prix de la gendarmerie nationale. Nous avons partagé plusieurs sommaires et il a m’a toujours encouragé et soutenu dans l’écriture. Nous avions vaguement discuté d’écrire un roman historique ensemble, qui se passerait au Québec ; projet resté dans nos têtes, et qui ne se réalisera donc jamais.
Je présente toutes mes condoléances à sa famille. Patrice est parti comme il a vécu et comme il a écrit : sans tricher.
Tu vas me manquer, amigo. Passe le bonjour à Bruno quand tu le croiseras là-haut…